Jury de soutenance de thèse : La transmission inter et trans-générationnelle et les mécanismes de l'élaboration de l'expérience de déportation et d'exil en Sibérie. Le cas des anciens déportés lituaniens et de leurs descendants
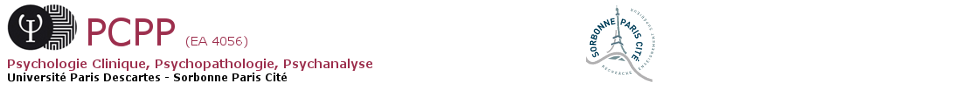 La transmission inter et trans-générationnelle et les mécanismes de l'élaboration de l'expérience de déportation et d'exil en Sibérie. Le cas des anciens déportés lituaniens et de leurs descendants : thèse de Goda Burksaityte soutenu à l'Université Paris Descartes sous la direction d'Alberto Konicheckis, Professeur de Psychologie Clinique et Psychopathologie à l’Université Paris Descartes et co-responsable du théma "Groupe, famille, institution" du Laboratoire de Psychologie clinique, Psychopathologie et Psychanalyse - PCPP, E.A.4056, Paris Sorbonne Cité, École doctorale ED261 de l'Université Paris Descartess.
La transmission inter et trans-générationnelle et les mécanismes de l'élaboration de l'expérience de déportation et d'exil en Sibérie. Le cas des anciens déportés lituaniens et de leurs descendants : thèse de Goda Burksaityte soutenu à l'Université Paris Descartes sous la direction d'Alberto Konicheckis, Professeur de Psychologie Clinique et Psychopathologie à l’Université Paris Descartes et co-responsable du théma "Groupe, famille, institution" du Laboratoire de Psychologie clinique, Psychopathologie et Psychanalyse - PCPP, E.A.4056, Paris Sorbonne Cité, École doctorale ED261 de l'Université Paris Descartess.
Goda Burskaityte bénéficie d’un contrat doctoral pour la réalisation de sa thèse et assure également une mission d’enseignement dans le service de la Psychologie Clinique de l’Institut de Psychologie.
Membres du jury
KONICHECKIS Alberto, Professeur des Universités, Université Paris Descartes (directeur de thèse)
ROBERT Philippe, Professeur des Universités, Université Paris Descartes (président du jury)
FELDMAN Marion, Professeure des Universités, Université Paris Ouest – Nanterre la Défense (rapporteur)
JOUBERT Christiane, Professeure des Universités, Université Toulouse 2 (rapporteur)
ALTOUNIAN Janine, essayiste et traductrice (membre invité du jury)
Résumé
Les déportations des populations en Sibérie sont une des formes de répressions politiques menées dans l'EX URSS durant le régime stalinien. En Lituanie, pays faisant parti de l'ancien bloc soviétique, c’est environ 130 000 personnes qui ont été déportées (1940-1941, 1945-1953). Pour les familles qui survivent au voyage et aux premières années particulièrement difficiles, une nouvelle vie se tisse progressivement créant un enracinement paradoxal sur cette terre d'exil forcé. Or, en deçà des effets pathogènes potentiels sur l'individu et le groupe touchés, les violences collectives génèrent également ici de nouvelles formes de vie psychique et de nouveaux liens. Durant l'exil, des couples se fondent et une descendance vient au monde, portant une appartenance double et potentiellement conflictuelle véhiculée dans ce statut d'enfant de déportés. La politique de déstalinisation (dès 1953) accordera progressivement à ces familles un droit de retour. Mais ils retrouveront un pays changé, aux prises avec le régime totalitaire accueillant leur histoire par le déni et la diffamation. Leurs persécutions et discriminations ne cesseront qu’à la chute de l'URSS et à l'avènement de l'indépendance en 1990, qui marquera l'ouverture d’espaces collectifs de commémoration. Des destins individuels et familiaux distincts se déploient quant aux possibilités de sortir d'une répétition traumatique, d'intégrer, voire de créer, à partir de ces transmissions familiales marquées par la violence. Pour certains, des espaces et des rituels individuels ou collectifs spécifiques émergent, et se voient parfois revisités et réinventés d'une génération à l'autre ; tels que le travail de (co)-écriture, le voyage (de retour) dans les anciens lieux d'exil, les différentes voix de témoignage. Ils œuvrent au sein d'une quête de sens, à une création de symboles, et à l'inscription à la fois dans la mémoire (collective et intime) de l'histoire familiale, et de l'Histoire longtemps restée en manque de mots et de lieux. Mots-clés : Violences collectives, subjectivation, transmission inter et trans-générationnelle, système totalitaire.
Evaluation de Janine Altounian
En tant que membre invité à ce jury, non universitaire et, a priori, étrangère à la transmission traumatique que vous étudiez dans cette thèse, je ne suis pas en mesure d’évaluer, à proprement parler, votre travail. En m’autorisant cependant du conseil que me donnait le professeur Konicheckis de ne pas faire une lecture approfondie de cette thèse mais de « soulever les questions relatives à mes travaux et à mes conceptualisations actuelles «, je dirai seulement en quoi la lecture de votre thèse a rencontré mon intérêt, bien que, je dois l’avouer, je n’aie consenti à faire cette lecture qu’à reculons. En effet, découvrir la réalité les violences du monde, autres que celles qui me sont familières en tant qu’héritière de survivants du génocide arménien de 1915, éveille en moi une grande colère et un dégoût face au laisser faire et l’impuissance du monde devant ces crimes, une colère aussi de voir que la seule chose qui est encore en notre pouvoir c’est de sublimer notre souffrance en faisant de ces événements scandaleux un objet d’écriture ou d’étude universitaire.
Cette lecture a pourtant éveillé aussi en moi un étonnement désireux d’en savoir davantage sur une page d’histoire que, globalement, j’ignorais. Je me vois donc obligée de remercier Monsieur le professeur Konicheckis de m’avoir offert, par son invitation, l’occasion de réfléchir à cette constatation surprenante que la TRANSMISSION TRANSGENERATIONNELLE DE L'EXPERIENCE DE DEPORTATION ET D'EXIL EN SIBERIE DES ANCIENS DEPORTES LITUANIENS ainsi que LES MECANISMES D'ELABORATION DE CETTE EXPERIENCE chez leurs DESCENDANTS présentent d’innombrables similitudes avec les processus correspondants dans ce qui s’est transmis aux descendants des survivants du génocide arménien de 1915 - objet de mon écriture depuis 1975. Ces innombrables similitudes, alors qu’il s’agit de contextes historiques et géographiques absolument différents, montrent éloquemment à mes yeux la pertinence de votre travail. Je me bornerai donc à relever ces similitudes tout en remarquant au passage quelques différences avec le cas arménien et, parfois, quelques désaccords dans mon interprétation de certains témoignages de rescapés.
Mais avant toute chose, j’aimerais dire que j’ai été touchée par une similitude dans la motivation de mon travail avec celle du vôtre que j’ai perçue dans l’hommage que vous rendez, p.4, « À mes ancêtres féminines, qui me sont parvenues via les mythes familiaux, et qui m’ont appris à aller jusqu’au bout ». Il m’arrive en effet de penser que je dois ma vie et mon travail « jusqu’au bout » à ma grand-mère paternelle, Nahidè Altounian, que je n’ai pas connue et qui apparaît dans deux scènes significatives du Journal de déportation de son fils, mon père. Je me permets de les citer car ce Journal a représenté dans le cours de ma vie, d’une part ce que vous désignez par « boite de Pandore », telle que celle-ci fait irruption dans la vie de différents protagonistes de votre thèse et, d’autre part, ce que vous désignez par le concept de « récit réparateur », en précisant même (92/93) que « moment fondateur pour [mes] travaux », ce Journal « illustre […] ce possible déploiement vivant et créateur puisant dans une histoire familiale d’une violence inouïe » :
« De nouveau ils se sont mis à battre ma mère. Nous deux frères, nous pleurions. […] Ils ont dit à ma mère : « Ton malade est mort». Et ma mère: « Nous partirons quand nous aurons enterré le mort. » […] Les autres […] abandonnaient les morts et la nuit les chacals les dévoraient […] Je suis allé voir [… ] le chef du convoi de déportation. Je lui ai dit : « Laisse-nous aujourd’hui, nous partirons avec le prochain convoi avec les autres.» Heureusement il n'a rien dit. […]. Nous avons creusé une fosse long de deux archine[i] et ayant payé cinq kourouchs au Derder [ii] nous avons enterré mon père. » [iii]
Nous voyons là dans quel contexte de violences cette femme parvient, au péril de sa vie, à poser un acte symbolique garant de dignité humaine pour elle et son éventuelle descendance.
« Nous n’avions plus d’argent, c’est pourquoi nous avons commencé à manger des herbes. […] on a vu qu’on allait mourir. On faisait à peine deux pas et on tombait par terre. Ma mère a réfléchi. « Moi, pour mourir, je mourrai, vous, il ne le faut pas. » C’est ainsi qu’elle nous a donnés, nous deux, aux Arabes.[iv]
Pour revenir à votre thèse, l’enrichissement que m’a apporté sa lecture a été pour moi de trois ordres,
Premièrement, j’y ai trouvé une confirmation de mes propres hypothèses à partir de ce qui m’avait été transmis d’un héritage appréhendé dans le cadre de la cure analytique, alors que je lisais là un travail de recherche « scientifique » obéissant à des critères universitaires. La subjectivation de ma propre histoire qui m’avait poussée à en témoigner se voyait relancée de cet autre lieu qu’était celui de la recherche et du recueil de témoignages. Je lisais là un discours qui théorisait certes autrement, mais tout compte fait avec une certaine analogie, mon expérience d’héritière d’une autre page de l’histoire. Je ne pouvais pas m’empêcher de constater une nouvelle fois qu’il fallait prendre connaissance du traumatique d’un autre héritage que le sien pour découvrir ses similitudes avec le sien, pour réduire le clivage qui les aurait, par ignorance ou résistance, différenciés et pour éviter ainsi de verser dans la paranoïa. Autrement dit, en me faisant prendre plus nettement conscience de ce qui m’avait été transmis de traumatique ou au contraire de constituant dans mon héritage – plus nettement grâce à l’altérité d’une approche différente - la lecture de votre thèse contribuait à mon propre travail analytique.
Deuxièmement cette lecture m’a permis de réfléchir, pour la première fois, au statut de mon écriture, à l’écart existant entre celle-ci qui porte sur les effets de la publication en 1982, aux Temps modernes, du Journal de déportation de mon père et une écriture qui transmet les produits d’une recherche, relayés par exemple par le Journal d’Angelé, d’Ana et de Julija, une écriture qui transmet par conséquent un savoir censuré sur le crime, une vérité interdite. En qualifiant mon travail d’« empreint d’une esthétique littéraire » (92), vous faites notamment preuve d’une grande perspicacité. Vous sentez qu’il y a une différence entre les conditions promouvant mon écriture d’héritière et celles présidant aux comptes rendus de la recherche.
En fait, ce n’est pas, dans mon cas, d’une « esthétique littéraire » qu’il s’agit. Ce que j’ai l’habitude d’appeler une « écriture d’analysante » ne peut affranchir l’écrivant du poids traumatique de son histoire que si ce qu’il est acculé à écrire est lesté du plaisir, disons « littéraire », à cet affranchissement par les mots, et ce plaisir provient d’un investissement particulier des mots de la langue qui contribue au travail analytique. Il s’agit en somme d’une écriture performative semblable à ce qui s’échange dans l’espace du transfert. Le temps ne me permet pas de comparer, par ex., les passages où je décris à travers ma propre expérience de fille la confrontation à une paternité empêchée que, de votre coté, vous repérez chez les déportés sous forme de souffrance, par ex., chez le père d’Angelé (247). L’écriture d’une analysante cherche à traduire en mots ce qui est ressenti par l’écrivant, certes en référence à telle ou telle théorisation, mais sa source ne se situe pas dans cette théorisation. Elle serait plutôt une verbalisation secondarisée de l’éprouvé dans la cure, parfois même l’éprouvé d’un défi ou d’une rébellion. On pourrait ainsi penser que la culture de mon père ayant été détruite, il ne m’est resté comme institution que son Journal de déportation. Mon écriture viserait ainsi à « déplacer «, dévoyer l’institution de son/mon pays d’accueil qui m’a permis d’écrire sur la transmission psychique chez les Arméniens et donc de rencontrer grâce à votre travail les déportés lituaniens.
Enfin, troisièmement, je pourrais vous livrer qui seriez alors mon « témoignaire » mon propre témoignage de mère et grand-mère dans ce que je vois à l’œuvre de transmis ou de refoulé chez mes 3 enfants et mes 7 petits enfants. Mon observation confirme exactement les différents destins de la transmission traumatique transgénérationnelle, telles que vous les constatez chez les anciens déportés lituaniens mais aussi telles que vous les constateriez dans ma propre famille si vous l’aviez, elle aussi, étudiée. Quand, lors de la discussion de mes interventions, on m’interroge sur les effets éventuels de la transmission dans ma propre famille, je réponds en général : « Je suis de la deuxième génération, je sens chez certains de mes enfants ou petits enfants un embarras silencieux derrière lequel se cache une attention timide à mes faits et gestes lors de tel ou tel événement culturel ou politique. Je perçois chez d’autres une résistance défensive à mobiliser au contraire leur attention sur cet héritage qui les détournerait de l’urgence à construire leur propre vie - attitude qui a été également la mienne jusqu’au début de ma première psychanalyse en 1968, entreprise pour pouvoir enfin entendre ce qui était assourdissant. Mais ce dont je suis sûre, c’est qu’après ma mort, la plupart d’entre eux liront ou parcourront mes livres et en feront quelque chose »
Pour conclure ce rappel des trois sortes d’enrichissement que j’ai ressenti en lisant votre thèse, je résumerais ainsi ce que je lui dois : d’une part, ces similitudes ont allégé en moi le poids de mon héritage puisque je retrouvais les mêmes formes de violence dans un héritage semblable au mien - en dépit d’une conjoncture historique différente - d’autre part, cette lecture m‘a amenée à réfléchir pour la première fois – et c’est vraiment son mérite - à ce qui différencie une écriture, née de la subjectivation après coup d’un désastre dont les effets hantent inconsciemment un héritier, et une autre, née du désir de dénoncer les circonstances objectives de ce désastre provoqué par une politique criminelle.
Je n’énumérerai pas l’ensemble des similitudes que j’ai constatées entre mon expérience d’enfant au sein de ma famille revisitée dans la cure et la transmission des anciens déportés lituaniens, telle qu’elle est décrite dans votre thèse. Je ne retiendrai que ce dont l’évocation provenant de ce lieu tiers d’énonciation m’a fait prendre « plus nettement conscience », comme je disais plus haut, pour constater que je n’avais pas rêvé, pas inventé ce dont je parlais dans mes livres.
Pour ne citer que quelques unes de ces similitudes, je les retrouvais en 57 : La maison hantée par les fantômes, en 84 : L'envahissement du psychisme de l'enfant par le passé parental ou familial, en 83 : Le deuil gelé parental et Le clivage qui se transmet de parents à enfants avec en 201 : La conflictualisation dedans/dehors, en 85 : L'appropriation et l'intrusion comme seul mode d’amour des parents, en 164 : Le deuil de la féminité, en 194 : La fonction singulière de questionner ou de s’interroger chez un enfant de la famille, en 137 : l’enfant devenant dépositaire des parts inélaborées de son histoire familiale, en 203 : L’enveloppe groupale potentiellement génératrice et protectrice de la famille ou en 242 : L’appareil psychique groupal qui » offre un lieu de transformation et de métabolisation à ses membres, qui, en 196 : peut œuvrer à une co-création des rituels et des espaces commémorant l'histoire familiale longuement déniée, ou en 241 Les expériences familières qui créent une enveloppe sonore (les chants du pays, les prières récitées dans le dialecte natal), en 213 : les multiples passages rendant compte de la naissance d’une vie collective en exil, en 214 : La préservation par les exilés des rituels les liant à leur vie d’avant les persécutions, en 167 La transmission de la religion, un bon objet interne qui vient réunir, tisser des liens entre les déportés, en 186 : Le maintien d’une activité artisanale où savourer les fruits de son travail constitue des labeurs à forte valeur de symbolisation ainsi qu’en 193 : L’injonction parentale, d’être fidèle à ses appartenances, en 227 : Le besoin crucial chez tout héritier d’objets ou de lieux qui assurent son inscription en mémoire tout comme sa transmission, chaque génération ayant sa part de symbolisation à accomplir, en 249 L’ouverture d’une boite de Pandore qui contribue à une inscription des morts dans la mémoire familiale et participe à l’accomplissement du processus du deuil, en 216 : L’absence de sens et la quête du sens, la conflictualisation du monde du dedans et de celui du dehors n’étant pas possible, en 222 : L’écoute de récits ne prenant pas encore sens, en 247 : Le travail d’écriture, qui rend compte d’une forme de résistance ou d’élaboration de l’héritage traumatique.
J’interromps cette liste qui serait trop longue pour m’arrêter sur certaines divergences de vue ou au contraire sur des confirmations précises que je voudrais apporter à certaines de vos observations:
- À propos de la perturbation des processus de différenciation et d'altérité, qui créent des relations familiales basées sur la fusion, l'emprise ou l'exclusion, notée dans mes écrits en p. 89, je me suis étonnée qu’il n’est jamais fait référence dans votre thèse au concept d’incestualité élaboré par Jean Claude Racamier, alors que sa première partie se réfère à de très nombreux auteurs. L’œuvre de Racamier démontre à mes yeux de façon magistrale comment le règne de l’emprise chez les familles de survivants rend très difficile la séparation et l’autonomisation des enfants.
- Quand il est noté également chez moi en 90 que les parents sont invalidés dans leur fonction protectrice et de représentation, au moins dans les premières générations de survivants, j’aurais envie de dire que l’invalidation de la fonction de représentation concordait bien avec mon expérience mais non avec celle de la fonction protection car la création d’un appareil psychique groupal familial créait justement cette enveloppe groupale potentiellement génératrice et protectrice de la famille décrite en plusieurs passages de la thèse et non seulement en 203.
- À propos de la négativité dans les familles en 73, lorsque Michael, âgé de 10 ans, » avait tenté de parler de son arrière-grand-père paternel, mort dans les camps mais papa était trop triste pour en parler, alors il va dans son coin. Depuis il ne lui pose plus de questions », je ne pense pas qu’il y ait là de la négativité. Au contraire Michael a finement identifié la souffrance paternelle qu’il prend en charge et repéré les questions qui ne sont pas à poser. Le lien entre père et fils doit certes rester inexprimé dans la relation mais il n’est pas inconscient, il se vit justement dans ce respect du silence.
- Lorsque Angelé demande à sa mère en 168 « Mais c'est quoi le fruit des entrailles ? » et que celle-ci répond : « Répète, c'est comme ça qu'il faut ». Il s'agit de paroles castratrices et limitantes dites vous. Je ne serais pas de cet avis. Ce qui est structurant dans un monde où tout est perdu c’est l’instauration d’un rituel, par ex., celui de la prière et celle des limites à l’intérieur desquelles l’enfant doit faire seul ses recherches sur la sexualité. L’explication que donnerait ce qu’on appelle « éducation sexuelle » ne répondrait en rien à la quête de l’enfant. La réponse de la mère n’est pas, à mes yeux, castratrice, mais simplement sécurisante par l’interdit qu’elle pose : « c’est comme ça »
- À propos du témoignage en 124 qui ne peut émerger que si le langage peut s’appuyer sur les destinataires actuels réactualisant la fonction tierce, les pratiques génocidaires visant la destruction chez le survivant, de sa capacité de témoigner, pour soi ou autrui. J’ai toujours soutenu que seul l’héritier a cette capacité. Cette thèse en est la preuve éclatante. C’est ce que confirment également les rencontres que me demandent depuis quelque temps des enfants ou petits-enfants ou arrière petits enfants de survivants qui m’écrivent parce qu’ils ont trouvé tel ou tel document relatif à un de leurs ancêtres.
- Il est très souvent question dans cette thèse de la confusion dans les témoignages ou dans les souvenirs comme par ex. en 155 les effets désorganisateurs d’une entreprise de parole dans la résistance d’Angelé à parler, en 218 l'histoire reste toujours très floue et disparate, constituée de bribes dans lesquelles vous vous perdez dans l’écoute, en 219 : on se demande par qui et quand ? Les repères quant au sujet et au temps du récit manquent cruellement. Ce « dit » se réfère, à la mère de Laima, morte depuis plusieurs années, mais ne cessant d'apparaître au présent dans ses propos, en 220 : Ainsi, vous peinez à situer le défunt dans la lignée générationnelle, tout comme dans l'appartenance des sexes, en 258 : le temps circulaire qui semble envahir cette dame constitue l’antithèse du « temps générationnel » organisant les transmissions familiales. C’est ainsi qu’elle s’est montrée à la fois confuse et confusionnante dans ses propres tentatives à voustransmettre son histoire. Il semblerait que vous vous trouvez aux prises avec l'attaque de la pensée. Ce symptôme m’a beaucoup parlé. Je ne retiens jamais les données de l’histoire du génocide de 1915 et le symptôme de cette confusion se manifeste toujours quand mes petits enfants ou neveux m’interrogent.
- À propos en 250 du voyage qui participe chez un héritier au travail de subjectivation de l’histoire familiale et de sa propre origine, à l’appropriation active des expériences transgénérationnelles, je dirais que
ce fut impossible pour moi 1- lorsque j’allais à Bursa en 2014 et fus obligée de retourner très vite à Istanbul en raison d’un malaise à la vue des maisons abandonnées, effondrées du quartier arménien, et 2- lorsque je fus obligée de détourner vers l’Arménie le pèlerinage à Diyarbekir (sur les traces des monuments arméniens en Turquie) que j’avais projeté de faire en Turquie avec ma famille avec l’organisation Terre et culture Du 9 au 18 Août 2015, en raison de violences dans cette région.
- Une des choses qui m’a le plus intéressée dans cette thèse c’est la grande différence entre l’écrasement de l’univers culturel traditionnel chez les survivants dans les pays du bloc soviétique 92 et le privilège des survivants arméniens transplantés en France, dans les années 20, dans un pays d’accueil laïque où au « dedans » de la maison pouvait très bien se préserver l’univers traditionnel, comme je l’ai personnellement vécu.
- L’autre élément serait la comparaison en 174 de l’accueil réservé aux survivants en Lituanie soviétique qui donne lieu à une immense désillusion et le soit disant « retour à la mère patrie » qu’ont effectué en 1947 certains Arméniens de la diaspora de France en obéissant à l’invitation de Staline. Plusieurs campagnes de « rapatriement » ramènent ainsi à Erevan près de 180 000 rescapés ou descendants de rescapés [v]. De France, ils sont 7 000 en 1947. Déçus, la plupart d’entre eux ré-émigreront à partir de 1956, au terme de démarches difficiles pouvant traîner pendant une quarantaine d’années [vi], parfois après un passage au Goulag[vii].
- À propos de « la boite de Pandore » en 92/93 : « Altounian soutient que le moment fondateur pour ses propres travaux sur l’héritage traumatique consiste en la découverte du manuscrit paternel racontant sa traversée subjective du génocide arménien. Ainsi, la richesse de l’œuvre même d’Altounian illustre une nouvelle fois ce possible déploiement vivant et créateur puisant dans une histoire familiale d’une violence inouïe », en 206 : « Pour devenir sujet de son histoire, il incombe à chacun de ses futurs dépositaires de se les approprier, métaboliser, symboliser, la quête de la subjectivation. n'étant jamais acquise une fois pour toutes, elle continue la vie et les générations durant », en 231 : « Cet acte semble nécessaire pour inscrire enfin cet ancêtre démuni de sépulture parmi les morts », je pourrais apporter les précisions suivantes:
L’ouverture de cette boite de Pandore s’est faite pour moi grâce au 1°) Tiers culturel, 2°) Tiers politique : L’appropriation de mon histoire familiale se fit 1°) par ma lecture en 1975 D’Un génocide exemplaire de Jean Marie Carzou, premier événement éditorial parlant du génocide arménien dont je mis le contenu en lien avec l’atmosphère accablante que je vivais à la maison et celle de la traduction que je fis faire en 1978 du Journal de déportation de mon père, découvert 8 ans après sa mort, 2°) La prise d’otages au consulat de Turquie en septembre 1981, acte de Terrorisme « publicitaire » pour rappeler l’existence du génocide arménien me rendit possible de publier ce Journal de déportation aux Temps modernes en février 82. J’ai repris cet article dans mon premier livre de [viii]( rassemblement tous mes articles des Temps modernes de 1975 à 1988) et en dans un ouvrage collectif où son traducteur, moi et des psychanalystes commentent ce Journal de déportation [ix]
[i] « Un archine mesure approximativement 75 cm ».
[ii] « Prêtre marié de l'Église arménienne ».
[iii] Mémoires du génocide arménien, Héritage traumatique et travail analytique, Vahram et Janine Altounian, avec les contributions de K. Beledian, J.F. Chiantaretto, M. Fraire, Y. Gampel, R. Kaës, R. Waintrater, PUF, 2009 p. 24.
[iv] Mémoires du génocide arménien, op. cit. p. 28.
[v] 42 000 pour la période 1921-1936, 100 000 en 1946-1948, 32 000 de 1962 à 1982. Cf. Claire Mouradian, « l’immigration des Arméniens de la diaspora vers l’Arménie soviétique, 1946-1962 », Cahiers du monde russe et soviétique, 20-1, 1979, pp. 79-110 : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/cmr_0008-0160_197...
[vi] Cf. Lucy et Jean Der Sarkissian, Les pommes rouges d’Arménie, Paris, Flammarion, 1987. Partis de Valence en 1947, ils mettront près de quarante ans à pouvoir revenir.
[vii] C’est le cas du dessinateur humoristique Hoviv (René Hovivian, 1929-2005) ou d’Armand Maloumian, qui a raconté son périple dans Fils du Goulag, Presses de la Cité, 1976.
[viii] « Ouvrez-moi seulement les chemins d’Arménie »/ Un génocide aux déserts de l’inconscient (Préface de René Kaës), Les Belles Lettres/ Confluents psychanalytiques, 1990, 2003.
[ix] Mémoires du génocide arménien/ Héritage traumatique et travail analytique, op. cit.
